By YVES BONNEFOY.
QUE JE VOUS écrive, Shakespeare, pourquoi ? Vous apporterait-on ma lettre – sur la scène où vous parlez à vos comédiens, ou sur le chantier de votre salle en travaux, ou à la taverne, à discuter ferme de ces événements de votre société qui vous préoccupent, je le sais bien-, vous la mettriez dans votre poche, vous l’oublieriez. Et, d’ailleurs, pourquoi vous poser des questions ou vous faire part de remarques auxquelles vous ne vous intéresseriez pas ? Ce n’est pas que vous ne vous souciez de ce qui nous retient, nous, quand nous vous lisons. Mais votre façon d’y réfléchir ne se situe pas au niveau d’une pensée avertie de soi mais dans votre travail très désordonné sur vos pièces, en ces heures où les intuitions subconscientes ou les demandes de l’inconscient ne sont plus réprimées, en tout cas aussi durement, par les mots et les convictions de l’intellect.
Je vous vois, vous êtes debout dans un coin du théâtre, il y fait froid, il y a là on dirait du vent, vous parlez à quelques hommes, jeunes et vieux. L’un, ce va être Hamlet, un autre Ophélie. As-tu une idée à leur expliquer, non, Hamlet s’écrit en cet instant même, ici, dans des phrases qui te viennent, qui te surprennent, c’est la quasi improvisation de quelques jours partagés entre ta table, je ne sais où, et la scène : un texte, certes, mais avec des ratures à vif, comme quand tu entends, ainsi en ce moment même, ton futur Hamlet ne pas trop comprendre ce que tu essaies de lui dire. Des ratures, car tu ne sais guère plus que lui ce que veut ce prince, cette ébauche de personnage dont les reparties sont encore si évasives. Ce qui paraît de lui dans tes mots vient de par dessous ce que tu as imaginé ou projette. Et cela, certes, parce que la grande pensée est, comme j’aime dire, figurale. Faite de symboles qui nous prennent de court, d’impressions qui embrasent tout notre corps. Aurais-tu préparé Hamlet, médité le sens que tu donnerais à ses personnages, à leurs rapports, nous ne te lirions plus aujourd’hui, tu n’aurais fait que du Ben Jonson. Ah, je te vois si bien, intuitif comme tu l’es, et heureusement ! Tu cours à travers le texte comme tu courras tout à l’heure à travers la ville, cherchant de l’argent ou des aventures. Tu bâcles – dirait Ben Jonson – les reparties, les peurs, les appels, les soliloques, parce que tu ressens, obscurément mais c’est ton génie, qu’il faut faire vite pour ne pas se laisser rattraper par les idées toutes faites. Je pense que tu as écrit Hamlet en seulement quelques jours. Tu ne me démentiras pas.
Une réflexion consciente, chez toi ? Oui, il y en a eu une, mais ce fut seulement la fois où tu pris recul, par rapport à ce travail à la scène, et parce que quelques-uns pas très loin de toi, à l’Université, à la Cour, te regardaient de haut, se disant poètes, l’étant parfois. Cela s’est passé, je puis même le remarquer, assez peu d’années avant cet Hamlet d’aujourd’hui qui en est selon moi la conséquence. Une méditation alors, et tout un moment, qui t’a permis de comprendre que tu avais raison de faire confiance à cette hâte de l’écriture déjà si aisément perceptible dans tes drames qui s’inspiraient de l’histoire de l’Angleterre.
Cette réflexion, avant ta nouvelle époque, Jules César d’abord, celle qui fait qu’aujourd’hui encore nous t’aimons tant ? En bien, pour commencer, ce fut un regard sceptique, ironique, sur ces sonnets que l’on écrivait de toutes part, durant ces mêmes années, chez les lettrés, chez les doctes. Ce fut prendre conscience – lisant Spenser, lisant même le si émouvant et noble Sidney, et parcourant, avec quelle impatience, quel mépris, les pages exsangues de leurs imitateurs éhontés – que ce qui naît dans le poème réglé par des formes a priori décidées, closes sur elles-mêmes, ce ne peut être qu’une simplification dans l’appréhension des sentiments et des êtres, une occasion de stéréotypes en apparence surtout risibles, en fait dangereux, dévastateurs.
Sont bien impossibles, assurément, dans ces quatorze vers idéalisants, exclamatifs, les grandes rencontres que tu avais faites, toi, dans Richard II par exemple ou dans Henry V, en fait si souvent dans tes pièces historiques : celles d’hommes et femmes débordant de désirs, de passions, en cela imprévisibles mais l’occasion de percevoir en soi-même des façons d’être semblables, avec cette fois dans ces dernières la pleine et brutale, et déplaisante souvent, authenticité de la vie. Ces sonnets, un renoncement à la vérité ! Et en écrire, que c’est facile, toi-même tu peux montrer que tu sais en produire aussi aisément et même mieux qu’aucun autre : mieux, parce qu’en faisant vibrer dans le son, le beau son des mots des harmoniques que tu es seul à entendre. En écrire, d’harmonieux, de melliflus, d’éloquents, de facilement mémorables, mais – ce fut cela ta réflexion toute spontanée – en vérifiant, toi, dans ton adhésion d’un moment à la forme fixe, l’illusoire qu’elle substitue mot par mot à la présence des êtres, la tentation qu’elle rend irrépressible d’observer l’homme par la lunette des rêves, la femme par celle des préjugés, la société par celle du consentement plus ou moins cynique à ses injustices.
Ah, fuir cette supposée poésie qui n’est que vaine littérature ! Retrouver sur scène, et avec une confiance renouvelée dans ses pouvoirs et une ambition de ce fait plus grande et même, tu en viens à le pressentir, plus haute, la forme ouverte, en mouvement, soulevée bien que non rompue par les affects, en dialogue constant avec l’inconnu de la vie : cette parole vive, fiévreuse, que tu avais appris à aimer et à pratiquer au feu de l’action politique ou guerrière, dans tes chroniques. Le pentamètre iambique, ce souffle de l’être au monde, mérite mieux que ces beautés de simple apparence que cisèlent les versificateurs, il est, il doit être la clef pour pénétrer dans la finitude essentielle de la vie, ce rapport à soi qui est celui des vraies joies, des vraies souffrances, – du vrai amour. Et l’œuvre sera alors non simplement le miroir de la société comme elle est mais celui de la vie comme il vaudrait mieux qu’elle soit, une leçon d’existence.
QUE JE VOUS écrive, William Shakespeare, non, vous ne me liriez pas, vous avez trop à faire avec cette parole de vérité qui s’est comme levée en vous, deux ans ou trois ans déjà avant cet Hamlet d’aujourd’hui, et va devenir demain et après-demain les cris déchirants de Lear, ceux de l’épouvante de Macbeth, et les revendications sublimes de Cléopâtre, les paroles exquises de Perdita. Vous ne m’entendriez pas, et certes c’est bien dommage, j’aurais tant de questions à vous poser. Mais ce que je puis faire, tout de même, c’est rêver que je vous glisse un billet, oui, prenez cette feuille pliée en quatre, pour vous demander la faveur d’une entrée dans la salle du spectacle, un des soirs où on jouera votre pièce. Une entrée par quelque porte dérobée, s’il en est une, car nous autres d’un autre temps, en tous cas nous vos meilleurs lecteurs désormais, des écrivains, des critiques, souvent des femmes, n’aimons pas trop nous mêler à ces robustes gaillards au verbe haut et à la lame facile qui se bousculent au seuil du Globe. Ceux-là n’aiment pas faire place à des gens qui ne leur ressemblent pas. Contrairement à vous, qui lisez Montaigne, l’Arioste, Machiavel. Qui avez même lu Goethe ou Baudelaire et jeté un regard sur Freud, encore que de celui-ci la sorte de réflexion vous ait paru, si je comprends bien, un peu simple.
Mais justement ! Si je vous demande de m’aider à entrer, ce soir, c’est pour que je puisse m’asseoir auprès de ce jeune homme d’une autre époque que je reconnais, c’est Lord Chandos, et qu’accompagnent deux messieurs qui eux aussi m’intéressent. L’un ne semble pas davantage que moi de Londres ou de votre siècle. Ses traits sont marqué du pli d’une subjectivité inquiète qui en votre temps n’affleurait pas aussi fort – ne s’alarmait pas de même façon – sur les visages : en tout cas les portraits que l’on a de vous n’en laissent paraître aucune trace. Mais l’autre homme, c’est évidemment un de vos contemporains sinon même un de vos amis. Il laisse bouger par dessus sa petite barbe les yeux brillants de malice d’une belle et libre philosophie. Or, le premier de ces deux tient une lettre, encore une, qu’il cherche à glisser dans une des mains de Chandos, sans trop de succès car le jeune homme à visiblement l’esprit ailleurs. Prenez-la, lui souffle-t-il, remettez-la tout à l’heure à Francis Bacon, c’est le moment puisque nous écouterons du Shakespeare. Mais Bacon pourra-t-il déchiffrer le texte de Hofmannsthal ? C’est peu probable puisque ces deux ou trois ne sont, comme nous tous, en tout cas ce soir, que des ombres parmi des ombres.
Je reporte mes yeux sur la scène, encore vide. Vide ? Je dirai même vacante, offerte sans réserve à tous les vents de l’esprit. Car il n’y a guère de choses, sur ce plateau. Une vague chaise, qui fera office de trône, s’il est besoin, une pièce d’artillerie qu’il faudra se garder de trop remarquer, tout à l’heure, car elle est là pour une autre pièce, demain. Pas de décor, pas de réquisitions des aspects du monde visible pour soutenir la parole des comédiens, mais, en revanche, cette trappe dans le plancher pour communiquer avec le monde invisible, autrement dit l’inconscient.
Cette scène sans rien que soi, ce lieu en somme métaphysique, est aux dimensions de l’espérance qui est chevillée au langage. Elle s’offre sans réserve à ce qui se cherche chez les poètes, et qui est toujours bien plus que la lettre de leur travail. Elle permet d’entrevoir de ce qu’il y a d’indicible dans leur perception du monde ou de dérobé dans leur relation à eux-mêmes : deux inexprimables dont la conjonction, la consumation réciproque, est l’événement de la poésie comme quelquefois dans votre théâtre, par exemple dans la lumière radieuse de certains moments du Conte d’hiver. – Shakespeare, au Globe, sur cette scène nue, avec même la chance du proscenium pour permettre à Hamlet d’avancer en soi, rencontrant ses grandes questions, Shakespeare, vous êtes seul au fond de vous-même avec ces questions, ces angoisses. Personne n’est là pour pousser près d’Hamlet un guéridon victorien., comme si cette grande parole avait à chercher où poser le crâne de « poor Yorick ».
Et je pense à cette extraordinaire invention qu’aura été, à quel moment ? où ? la mise en scène. À cet ajout de signifiants d’entrée de jeu schématiques – ce profil d’arbre côté jardin, ce guéridon côté cour – en ce lieu et à cet instant où la voix des acteurs est envahie par les signifiés de la profondeur d’un texte qui est la vie en son devenir : ces pressentiments, ces terreurs, ces aspirations, ces vœux qu’aucune lecture de l’œuvre ne saurait identifier tous et comprendre complètement. Le metteur en scène a pourtant obligation de comprendre ; d’en passer par de la signification avant, quelquefois, de se retrouver en présence. Et quand il est grand, ce qui arrive, il saura d’instinct que ce détour est pour la poésie un péril auquel il se doit de faire face par beaucoup d’ardente exigence envers son propre inconscient. Si bien, je m’en avise, qu’il n’est que naturel que la mise en scène soit apparue à la fin de l’époque des Lumières, quand on chassait le spectateur de sa chaise ou petit fauteuil sur le plateau mais aussi nombre de préjugés de leur positions de commande dans la pensée. Quand la subjectivité pouvait donc commencer à prendre conscience de soi dans le roman gothique et la poésie de ces jeunes gens que nous avons dénommés des romantiques.
Et que de problèmes se posent, désormais, qui n’existaient pas sur votre scène du temps d’Élisabeth ou de Jacques ! Voyez, aujourd’hui, cette fin d’après-midi qui est d’automne, me semble-t-il, en tout cas la lumière dehors est déjà assez brouillardeuse, sous un ciel bas, et ce qu’il en reste dans la salle, c’est bien peu, un flambeau que l’on apportera sur la scène ou la brève flamme d’un mousquet pourront se détacher sur ce fond avec toute l’intensité qui est dans le rouge, tout son tragique, tout son appel à la pensée du tragique. Et cela, ce fut parfait pour jouer Jules César, où il y a ce flambeau, au moment le plus décisif, quand Brutus accepte enfin de se pencher sur son inconscient, de soulever cette trappe ; et c’est bien aussi pour jouer Hamlet maintenant, quand sur les remparts on se déplace de nuit, avec des lueurs sur le visage des arrivants, ou quand un roi qui a du noir dans son cœur réclame des flambeaux, des flambeaux encore, lights, lights, lights, après quoi son témoin fasciné s’écrie, et il faut bien le signifier par un effet d’éclairage encore, ‘Tis now the very witching time of night…
La nuit, la plus profonde nuit, avec tout son sens, est signifiable sur votre scène, Shakespeare, et de ce fait même ce qui l’est aussi, par contraste, par rebond de l’esprit, par espérance enfin libre de s’exprimer, oui, c’est aussi le jour le plus pur, la lumière des instants de retrouvailles, des épreuves terminées, de la vérité reconquise : Perdita qui n’est plus perdue. Votre expérience la plus intime de la lumière, mon ami, le vœu secret de votre théâtre et son dénouement, qui est notre bien, par vous légué, tout cela qui a son lieu dans les mots est préservable sur ces planches qui ne substituent aucun signifiant particulier à l’universalité des vocables de votre langue anglaise advenant à soi. Un privilège, remarquons-le, que les peintres n’avaient pas, même à votre époque. Sans doute pressentaient-ils, dans leur regard, dans le cœur, ces épiphanies dans le quotidien d’une lumière plus vraie, mais on attendait d’eux que, faute de mots, ils expliquent les situations qu’ils évoquaient par des choses qui risquaient regrettablement de retenir l’attention.
Leur intuition des possibles de la vie, ils la signifiaient, tout de même, en tout cas les plus grands, et parmi vos contemporains Caravage parvint déjà presque autant que l’extraordinaire Goya, votre proche, à signifier la nuit, l’intense nuit, et l’espérance au fond de la nuit, ce fut par des flambeaux, justement, et ces brusques visages qui paraissent dans leur clarté. Quant à Véronèse, ou déjà Titien dans sa Bacchanale des Andrians, ils ont presque rejoint, pour leur part, l’irréfutable et irrésistible lumière de fusion, de bonheur, d’apaisement que nous rêvons tous au fond de la nuit : ayant pris vers elle non la voie tragique des peintres du clair-obscur, que suit Goya encore à des heures, dans sa maison du sourd, mais celle, évidemment si risquée, si difficile, de la confiance.
Vos contemporains, Shakespeare, ce Caravage, ce Véronèse. Caravage peint en ce moment même, c’est à Rome, il s’est confié à la religion, dans sa Vocation de saint Mathieu la lumière vient du dehors, c’est en haut à droite, mais d’autres œuvres vont suivre, de grands zigzags, il mourra peut-être désespéré sur cette plage sauvage juste dans les jours vous écrirez le Conte d’hiver, votre pensée de la vraie résurrection, votre victoire. Et je vous vois d’essentiels rapports avec lui, mais plus encore avec un de ses disciples, qui meurt aussi, c’est étrange, en 1610, Adam Elsheimer. Elsheimer a creusé plus profondément que Caravage, à mon sens, dans la nuit de l’être. Et c’est parce qu’il avait en esprit ce jour enseveli que vous finirez par savoir délivrer, vous, des sables mouvants du langage. Je regarde sa Judith, qu’il va peindre l’année prochaine, ou dans deux ans. Mais c’est votre Lucrèce ! Avec la même pensée de meurtre mais – aussi bafouée serait-elle, aujourd’hui, demain – la même foi dans la vie. Shakespeare, ce peintre comme vous le dramaturge vous pressentez que votre moment dans l’histoire, Galilée nous rendant le ciel, pourrait s’ouvrir à cette intuition, la poésie même. Avec cette conviction insue de votre pensée consciente mais exigeante et hardie vous descendrez tout à l’heure, du haut des remparts d’Elseneur, au plus intense du noir pour y refonder le monde.
Je regarde cette scène où des spectateurs s’installent, mais qui est vide, métaphysiquement, vide comme la page blanche où en poésie la voix humaine se risque, si inquiète pourtant, si profondément blessée, si creusée de doutes. Un dernier pâle rayon de ce soleil de je ne sais où dans la ville ou mon rêve s’y attarde, mais c’est déjà assez de pénombre pour que quelqu’un, indistinct, puisse en présence d’un autre aussi peu lisible s’écrier, Who’s there? – après quoi l’action va commencer, le roi mort paraître avec sa réclamation ambiguë, l’archaïque du monde se réaffirmer un instant pour vite se disloquer quand, sur les tréteaux du théâtre dans le théâtre, des ombres encore, ombres parmi des ombres, vont elles aussi descendre si bas dans les lieux communs du langage – un ultime regard sur le sonnet, n’est-ce pas ? – qu’elles ne pourront que nous poser la question de cette fois la parole dans la parole … Et ces flambeaux alors, mais vraiment arrivent-ils, non, puisque Hamlet voit ces nuées passer dans le ciel, prenant, une belette, une baleine, les formes que les mots veulent. The very witching time of night ? L’abîme, comprenons-nous, qui est le fond du langage ? Je me dis que votre scène nue a été votre grande chance, Shakespeare, préservant pour vous qui en étiez digne le plus grand et seul vrai possible de la parole. Avez-vous été un éclectique, passant des comédies à la tragédie, de Vénus à Lady Macbeth, des corps heureux à l’évocation des pires souffrances, non, vous avez plongé vos mains dans le langage, y remuant les bonheurs et les détresses, les étonnements et les certitudes, le bien et le mal, le non-sens et les espoirs qui s’obstient,
Et comment ces mains s’y sont pris pour faire bouger cette boue, ces couleurs, ce froid, ces débuts mystérieux de chaleur, je voudrais bien vous le demander, c’était la raison de ma lettre, ou plutôt, non, je voudrais vous dire ce que j’en pense, vous expliquer ce que vous avez fait, car j’ai mon idée là dessus, en effet, vous acquiesceriez peut-être… Mais ce n’est pas le moment, je le vois bien, des spectateurs se sont déjà assis tout près de nous sur la scène, et je vois Chandos enfoncer distraitement dans sa poche, c’est vous qu’il regarde, en effet, la lettre que quelqu’un d’un autre temps, comme moi, lui a fait écrire. L’ombre s’étend sur ma page aussi, dans mes mots. Et quelqu’un, est-ce vous ? s’est écrié, Who’s there ? La représentation vient de commencer.
♦
The English-language translation (by Hoyt Rogers) of this text appears here in The Fortnightly. A previously published version in French appears here.
Note: A minor edit to correct a production error was made to this page subsequent to publication. 15 December 2014.






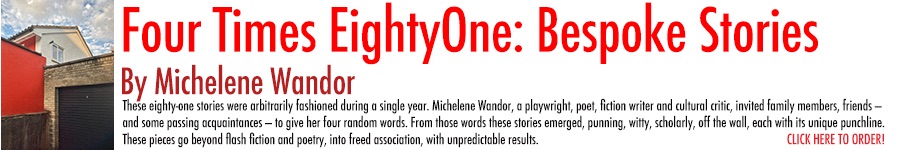














Post a Comment