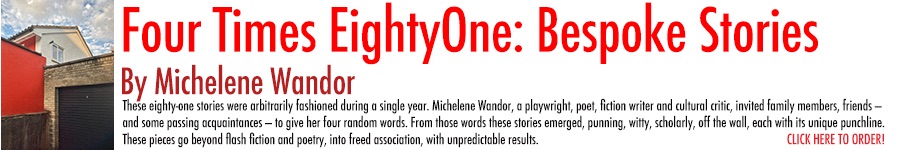ET MAINTENANT QUE C’EST LA PLUIE…
Et maintenant que c’est la pluie et le grand vent
de Janvier
et que les vitres de la serre
où je me suis réfugié
font, sous la pluie, leur petit bruit de verre
toute la journée.
et que le vent, qui rabat la fumée des cheminées,
dégrafe et soulève
les vignes vierges de la tonnelle,
Je ne sais plus où Elle est…Où est-elle?
A pas pleins d’eau, par les allées,
dans le sable mouillé
du jardin
qui nous fut à tous deux notre rêve de Juin,
Elle s’en allée…
et la maison
où nous avions, tout cet été,
sous les feuilles des avenues qu’on arrosait,
imaginé
de passer notre vie comme une belle saison,
la maison,
dans mon coeur, abandonnée, est froide
avec son toit
d’ardoise luisant d’eau,
et ses nids de moineaux
dénichés et pourris qui penchant aux corniches
et traînent dans le vent…
Il va bientôt faire nuit,
et le grand vent bruineux tourne les parapluies
et mouille au visage
les dames qui reviennent du village
et ouvrent la grille…
Mon amie
O Demoiselle
qui n’êtes pas ici,
cette heure-ci
passe, et la grille ne grince pas,
je n vous attend pas,
je ne soulève
pas le rideau
pour vous voir, dans le vent et l’eau,
venir.
Cette heure passe, mon amie;
Ce n’est pas une heure de notre vie…
et nous l’aurions aimée, pourtant, comme toutes
celles
de toute la vie
apportée simplement dans vos mains graves de
dame belle.
Vous êtes partie…
Il bruine
dans les allées
qui ont mouillé
vos chevilles fines.
Il bruine dans les marronniers
confus et sombres
et sur les bancs où, cet été, à l’ombre,
avec l’été
vous vous series assise, blonde!
Il bruine sur la maison et sur la grille et dans les ifs
de l’entrée
que, pour la dernière fois
peut-être je regarde, en songeant à mi-voix
peut-être pour la dernière fois :
“Elle est très loin…où est-elle…son front pensif
appuyé à quelle croisée?”
A la tombée de la nuit,
je vais fermer, aux fenêtres d’ici,
les volets qui battent et se mouillent,
et j’irai sur la pelouse
rentrer
un jeu de croquet oublié qui se mouille.
CHANT DE ROUTE
<<….des grandes routes où nul ne passe.>>
—JULES LAFORGUE
Un conquérant, puis tous, chantent :
Nous avons eu la fièvre
de tes marais.
Nous avons eu la fièvre et nous sommes partis.
Nous étions avertis
qu’on ne trouvait
que de soleil
au plus profond de tes forêts.
Nous avons eu des histoires
de brancards
cassés,
de fers perdus,
de cheveaux blessés,
d’ânes fourbus
et suants qui refusaient d’avancer.
Nous avons perdu la mémoire de ces histoires
que l’on raconte à l’arrivée ;
nous n’avions pas l’espoir
d’arriver.
Nous avons pris les harnais
pour nous en faire
des souliers.
Nous sommes repartis, à pied dans tes genêts
qui font saigner les pieds
et nos pieds ont saigné,
et nos pieds ont séché
dans ta poussière,
en marchant,
et nous avons guéri leurs plaies
en écrasant,
en marchant,
le baume et le parfums sauvages de tes bruyères.
Nous aurions pu asseoir
au revers des fossés
nos corps fumants et harassés.
Nous n’avions rien à dire : nous n’avions pas
d’espoirs.
Nous n’avions rien à dire; nous n’avions rien à boire.
Nous avons préféré la déroute
sans fin
des horizons et des routes,
des horizons défaits qui se refont plus loin
et des kilomètres qu’on laisse en arrière
dans la poussière
pour attraper ceux qu’on voit plus loin,
avec leur bornes
indicatrices de villes aux noms lointains
aux noms qui sonnent
comme les cailloux de tes chemins
sous nos talons.
Nous n’atteindrons jamais les villes de merveilles
qui ne sont que des noms
qui sonnent,
les noms des villes qui sont mortes au soleil.
Mais nous, nous voulons vivre au Soleil,
de tes cieux
avec nos crânes en feu,
et faire sonner sans fin les étapes de gloire
avec nos pieds d’étincelles.
Nous avons pour chanter des gosiers de victoire
et nous avons nos chants pour nous verser à boire
et nous avons la fièvre
de tes marais séchés au grand soleil
de tes routes de poussière
de tes villes de mirage.
Nous avons eu la fièvre
de tes forêts sans ombre – et tes bruyères des sables
avec leurs regards roux et leur parfums sauvages
nous ont donné la fièvre.
CONTE DU SOLEIL ET DE LA ROUTE
(A une petite fille)
− Un peu plus d’ombre sous les marronniers
des places,
Un peu plus de soleil sur la grande route lasse…
Des noces passeront, aux << beaux jours >> étouffants,
sur la grand’route, au grand soleil, et sur deux rangs.
De très long cortèges de noces campagnardes
avec de beaux habits dont tout le monde parle
Et de petits enfants, dans la noce, effarés,
auront de très petits << gros chagrins >> ignorés…
− Je songe à l’Un, petit garçon, qui me ressemble
et, les matins légers de printemps, sous les trembles,
à cause du ciel tiède et des haies d’églantiers,
parce qu’il était seul, qu’on l’avait invité,
se prenait à rêver à la noce d’Eté :
<<… On me mettra peut-être−on−l’a dit−avec Elle
qui me fait pleurer dans mon lit, et qui est belle…
(Si vous saviez−les soirs, quelquefois−ô mamans,
les pleurs de tristesse et d’amour de vos enfants!)
<<… J’aurai mon grand chapeau de paille neuve et
blanche ;
sur mon bras la dentelle envolée de sa manche…>>
− Et je rêve son rêve aux habits de Dimanche.
“… Oh! le beau temps d’amour et d’Eté qu’il fera,
Et qu’elle sera douce et penchée, à mon bras.
J’irai à petits pas. Je tiendrai son ombrelle.
Très doucement, je lui dirai “Mademoiselle”
d’abord−Et puis, le soir, peut-être, j’oserai,
si l’étape est très longue, et si le soir est frais,
serrer si fort son bras, et lui dire si près,
à perdre haleine, et sans chercher, des mots si vrais
qu’elle en aura << ses >> yeux mouillés – des mots
si tendres
qu’elle me répondra, sans que personne entende …”
− Et je songe, à present, aux mariées pas jolies
qu’on voit, les matins chauds, descendre des mairies
Sur la route aveuglante, en musique, et traîner
des couples en cortège, aux habits étrennés.
Et je songe, dans la poussière de leurs traînes
où passent, deux à deux, les fillettes hautaines
les fillettes en blanc, aux manches de dentelles,
Et les garcons venus des grandes Villes – laids,
avec de laids bouquets de fleurs artifiicielles,
– je songe aux petits gars oubliés, affolés
qu’on n’a mis, << au dernier moment >>, avec personne
− aux petits gars des bourgs, amoureux bousculés
par le cortège au pas ridicule et rythmé
− aux petits gars qui ne s’en vont avec personne
dans le cortège qui s’en va, fier et traîné
vers l’allégresse sans raison, là-bas, qui sonne.
− Et tout petits, tout éperdus, le long des rangs,
ne peuvent même plus retrouver leurs mamans.
− Un surtout…qui me ressemble de plus en plus !
un surtout, que je vois – un surtout… a perdu
au grand vent poussiéreux, au grand soleil de joie,
son beau chapeau tout neuf, blanc de paille et de soie,
et je le vois … sur la route …qui court après
− et perd le défilé des << Messieurs>> et des <>−
court après–et fait rire de lui–court après,
aveuglé de soleil, de poussière et de larmes …
♦
Alain-Fournier, demi-pseudonyme d’Henri-Alban Fournier, né le 3 octobre 1886 et mort au combat le 22 septembre 1914 (à 27 ans) à Saint-Remy-la-Calonne.
The English translation of these poems by Anthony Costello and Anita Marsh is here.